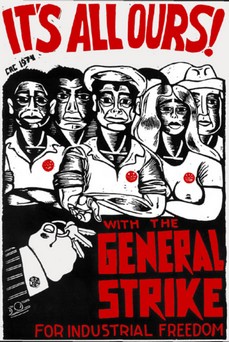B. A. Botkin, archiviste de l’American Folk Song à la bibliothèque du Congrès, est l’auteur de l’imposant livre (de presque mille pages) Treasury of American Folklore, paru en 1944. Produit en temps de guerre, l’ouvrage met en exergue patriotique le mythe de la « démocratie » et de l’« égalité » américaines. Non sans embarras, Botkin se voit cependant obligé de reconnaître « la malignité inhérente à beaucoup de héros, histoires et expressions populaires américaines, particulièrement dans leur traitement des minorités — Indiens, Noirs, Mexicains, Chinois, etc. ».
Authentique héros populaire, Joe Hill se distingue à de nombreux égards, et son rejet IWW de la société blanche arrive en tête de liste.
La police usa au cours de ses interrogatoires avec Joe Hill d’une expression étrange, mais révélatrice par contraste du rapport du poète IWW et de ses compagnons wobblies à cette curieuse configuration — mêlant aveuglement, hypocrisie et terreur — que James Baldwin appelait le « problème blanc ».
Pour son premier jour en prison, Joe Hill fut placé dans une cellule isolée à l’étage. Les flics lui annoncèrent qu’il était accusé de meurtre et le pressèrent d’avouer. « Je n’étais au courant d’aucun meurtre et c’est ce que je leur ai dit », écrirait-il plus tard au Comité des grâces de l’Utah. Sa blessure lui faisant perdre beaucoup de sang, Hill demanda à être emmené à l’hôpital. Mais les policiers continuèrent de le harceler pour lui extorquer des aveux, lui assurant que, s’il coopérait, on l’emmènerait à l’hôpital et qu’il serait « traité comme un Blanc » [Letters, p. 65, souligné par F. R.].
Comme Hill répétait obstinément qu’il n’était « au courant d’aucun meurtre », la police le qualifia de menteur. Hill refusa dès lors de répondre à ses questions. Elle se comporta vraisemblablement à son égard comme avec n’importe quel autre pauvre ou « suspect » sans recours placé dans de telles circonstances : autrement dit, il fut maltraité, voire torturé par ses « interrogateurs ». Hill confierait qu’il s’affaiblissait alors de jour en jour, « balançant entre la vie et la mort » pendant un temps [Letters, p. 64-65].
Beaucoup d’innocents ont craqué lors de tels interrogatoires, avouant des crimes qu’ils n’avaient pas commis. Mais Hill refusa de tomber dans le panneau. Comme il ne cédait pas, la police et la justice décidèrent en retour de ne pas le « traiter comme un Blanc ».
Hill personnifie ici encore l’esprit wobbly. Il se disait travailleur, esclave salarié, immigré et IWW avant tout. Nulle part dans ses lettres, chansons ou poèmes — pas plus que dans les souvenirs de ses amis ou anecdotes rapportées par des connaissances —, on ne trouve le moindre indice indiquant qu’il se considérait comme un « Blanc ».
Même si les positions des wobblies autour du « problème blanc » variaient considérablement, le syndicat en tant que tel rejetait violemment la « mystique blanche » dominante aux États-Unis, et a toujours plus ou moins violé les règles tacites de ce que des radicaux américains d’une autre génération appelleront la « structure du pouvoir blanc ». Leur sentiment d’être les héritiers du mouvement abolitionniste, leur dégoût de l’exclusivisme blanc des sections AFL et des syndicats du rail et, bien sûr, leurs efforts pour organiser Afro-Américains, Chinois, Japonais, Amérindiens, Hawaiiens, Mexicains et autres gens de couleur situent immédiatement les wobblies en dehors du conformisme de la « société blanche » et de ses mythologies raciales oiseuses. Révolutionnaires et marginaux déclarés, n’ayant « rien d’autre à perdre que leurs chaînes », beaucoup de wobs étaient également des critiques pertinents de l’idéologie blanche et de ses conséquences désastreuses. T-Bone Slim, que l’on peut considérer comme une sorte d’héritier de Hill en tant qu’auteur et personnalité symbolique du syndicat, formulait le problème avec le merveilleux aplomb qui le caractérisait :
Ne perdons pas de vue que nous sommes aux prises avec le « noble homme blanc », qui torture avec science autant qu’ingéniosité, réservant les promesses de la vie à une poignée d’élus et laissant ses « déchets » au plus grand nombre.
[T-Bone Slim, Juice Is Stranger Than Friction: Selected Writings, 1992, p. 156]
Il est difficile de préciser dans quelle mesure Joe Hill partagea la critique wobbly de l’idéologie blanche (ou y contribua). Nous avons en revanche la preuve qu’il partageait l’identification du syndicat avec le mouvement abolitionniste, comme le montre une de ses lettres où il compare les organisateurs IWW de son époque à John Brown. Pour chacun d’entre eux, la tâche consistait à libérer les esclaves, plus précisément à les inspirer et les aider à se libérer eux-mêmes.
Descendants consciencieux de John Brown et des abolitionnistes, Hill et d’autres wobblies reprenaient abondamment les thèmes essentiels et le vocabulaire de leurs précurseurs. La troisième phrase de Big Bill Haywood dans son discours inaugural au congrès fondateur définit la mission du nouveau syndicat comme « l’émancipation de la classe ouvrière de l’esclavage capitaliste ». Les mots « esclave » et « esclavage » figurent dans pas moins de neuf chansons de Joe Hill. Comme dans The Girl Question :
Come, slaves from every land.Come join this fighting band [1].
Arise, ye slaves of every nation,In One Union Grand [2].
For the workers we’ll make upon this Earth a paradiseWhen the slaves get wise and organize [3].
Les appels à « briser les chaînes » et à « se battre pour l’affranchissement » avec des références ironiques à la « vaniteuse classe des maîtres » figurent aussi dans les paroles de Joe Hill.
Ces images d’inspiration abolitionniste parsèment tout le Little Red Song Book. One Big Industrial Union de George G. Allen (sur l’air de Marching Through Georgia) commence par exemple sur ces mots :
Bring the good old red book, boys, we’ll sing another song.Sing it to the wage slave who has not yet joined the throng [4].
Voici le refrain de The Workers of the World are Now Awaking, de Richard Brazier :
It’s a union for true Liberty;It’s a union for you and for me;It’s the workers’ own choice,It’s for girls and boys,Who want freedom from wage slavery [5].
Et le refrain de Workingmen, Unite! par E. S. Nelson (sur l’air de Red Wing) :
Shall we still be slaves and work for wages?It is outrageous—has been for ages;This earth by right belongs to toilers,And not to spoilers of liberty [6].
L’abolitionnisme version wobbly ne se limite pas aux paroles du Little Red Song Book : il est patent dans toute la presse IWW, dans ses brochures, poèmes, tracts, dessins, histoires de feu de camp et discours de soapbox. Un des slogans de l’IWW les plus cités revient à Big Bill Haywood : « Derrière chaque dollar qu’un parasite empoche pour un travail qu’il n’a pas fait, il y a un esclave qui travaille pour un dollar qu’il n’aura pas. » Les procès contre l’IWW donnèrent également l’occasion de revendiquer l’héritage abolitionniste. Au cours du procès lié à la plus célèbre des grèves wobbly — celle qui eut lieu à Lawrence en 1912 —, Joseph Ettor et Arturo Giovannitti citèrent pour leur défense, avec fierté, les noms et pratiques révolutionnaires de Wendell Phillips, William Lloyd Garrison et John Brown. Giovannitti, Covington Hall et d’autres poètes IWW rendirent hommage aux abolitionnistes dans leurs poèmes [Justus Ebert, The Trial of a New Society, 1913, p. 135-136, p. 143]. Un ouvrage wobbly consacré à la violence contre les ouvriers aux États-Unis salue la mémoire d’Elijah Lovejoy, « l’imprimeur abolitionniste [...] assassiné par une foule esclavagiste » à Alton, dans l’Illinois, en 1837 [Delaney and Rice, The Bloodstained Trial, 1927, p. 52]. À la fin de son livre The IWW in Theory and in Practice — un des ouvrages les plus souvent réédités du syndicat —, Justus Ebert salue Lovejoy, Garrison et John Brown pour leur idéalisme inspirateur et leur pertinence révolutionnaire :
La presse de Lovejoy fut jetée à la rivière et Lovejoy lui-même fut assassiné peu de temps après. William Lloyd Garrison fut traîné une corde au cou dans les rues de Boston. John Brown fut pendu. Mais son âme est encore vivante, non seulement dans l’abolition de l’esclavage, mais aussi pour celle de l’esclavage salarié ; John Brown est encore vivant, réincarné dans les abolitionnistes des temps modernes. Rêveurs ! Oui ! [...] Les abolitionnistes de l’esclavage l’étaient aussi.
[J. Ebert, op. cit., p. 122]
Ce n’est pas pour rien que Carl Sandburg remarqua un jour qu’il connaissait « mieux les abolitionnistes après avoir découvert l’IWW ».
Les chansons et discours wobbly sur l’unité des esclaves et leur soulèvement pour vaincre leurs oppresseurs, sur l’abolition et l’émancipation et sur la création d’un paradis terrestre libéré de ses exploiteurs parasites, ne plaisaient guère aux oreilles de la « vaniteuse classe des maîtres ». Dans les années 1910 et au début des années 1920, alors que la Guerre civile et la reconstruction étaient encore présentes dans les mémoires, la nouvelle « classe des maîtres » — qui, comme les propriétaires d’esclaves avant la guerre, se trouvait être entièrement blanche — entendait dans le vocabulaire wobbly le tocsin de la révolte et de la révolution. Joe Hill et ses amis ne savaient sans doute pas grand-chose de l’histoire et de la culture afro-américaines, mais leur inclination en faveur des abolitionnistes et leur défense sans équivoque d’un syndicalisme réunissant tous les travailleurs, sans distinction de couleur, mettaient leur position bien en évidence. Pour les fils des privilèges et de la propriété privée, l’IWW ne signifiait pas seulement la guerre des classes — guerre contre le capitalisme —, mais aussi la guerre contre la suprématie blanche.
Dans sa lettre au Comité des grâces, Hill avait mis l’expression des flics « traiter comme un Blanc » entre guillemets, attirant l’attention sur une phrase particulièrement révélatrice que, immigré ayant passé la plupart de son temps en compagnie de wobblies, il n’avait sans doute jamais entendue auparavant. Ces guillemets montrent bien son refus absolu de la tortueuse proposition des flics, et son admiration avouée pour John Brown me paraît démontrer que, à l’instar de nombreux autres wobs, il ne voulait prendre aucune part dans le « jeu blanc ».
En fait, comme pour une majorité de wobs, son refus de se déclarer « Blanc » semble être pratiquement synonyme du refus d’être un scissorbill. En reprenant les grands mots d’ordre prolétaires — « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » et leur propre « Un tort fait à l’un est un tort fait à tous » —, les wobblies refusaient également de penser et d’agir en « Blancs ». Les maîtres des États-Unis refusèrent quant à eux de les « traiter comme des Blancs ». Ils se comportèrent avec Joe Hill comme ils s’étaient comportés avec John Brown. Ce dernier, bien sûr, avait organisé une insurrection armée, alors que Joe Hill n’avait fait qu’écrire des chansons, mais, dans les deux cas, l’esclavagiste s’était senti atteint et avait répliqué en conséquence, avec la répression maximale.
Dans son texte rédigé pour l’ouvrage de Claude McKay The Negroes in America (1923), Bill Haywood écrit que les IWW étaient « des travailleurs “étrangers à la loi ” et s’attiraient donc la sympathie des Noirs, qui représentaient une race “étrangère à la loi”. » Dans toute l’histoire du mouvement ouvrier aux États-Unis, aucune organisation ne fut sans doute moins traitée « comme des Blancs » que l’IWW. Les wobs furent arrêtés en masse, mis sur liste noire, calomniés, battus, victimes de coups montés, kidnappés, déportés, emprisonnés par milliers (et condamnés à de lourdes peines), couverts de goudron et de plumes, stigmatisés, torturés, tués, lynchés. Leurs publications — comme celles de leurs fellow workers de la Charles H. Kerr Company — furent plusieurs fois interdites, refusées par la poste, saisies et détruites. Beaucoup de leurs locaux de réunion, bibliothèques ou librairies furent dévastés par des hommes de main à la solde des patrons.
La chasse aux sorcières maccarthyste des communistes et autres radicaux de gauche pendant les années 1950 fut une abomination répugnante, mais elle n’est rien comparée à la campagne sanglante de violence déchaînée contre les wobblies trente-cinq ans plus tôt.
Soumis à ce terrorisme d’État sans précédent, beaucoup de membres de l’IWW ont laissé tomber, ont abandonné la lutte, changé de nom, quitté le pays. Quelques-uns sont devenus alcooliques, religieux ou, pis, des bureaucrates de syndicats AFL. D’autres sont devenus fous. Mais beaucoup s’accrochèrent et continuèrent le combat contre l’esclavage salarié. L’un d’entre eux s’appelait Henry Pfaff.
« Enfant de la rue, semi-nomade, anticonformiste, activiste prolétarien précoce », Pfaff arrive de Hongrie aux États-Unis en 1911 et adhère à l’IWW pendant la grève d’Akron deux ans plus tard, à l’âge de seize ans. À plus de quatre-vingts ans, toujours membre actif du syndicat, il déclara à l’occasion d’un entretien : « l’IWW m’a sauvé la vie. Si je ne m’étais pas retrouvé là-dedans [...], je me serais sans doute tué au travail comme beaucoup d’autres » [Stewart Bird et al., Solidarity for Ever, 1985, p. 92]. S’inspirant de la vision wobbly pour « changer l’Amérique et transformer la société du profit en société coopérative », le fellow worker Pfaff, se proclamant lui-même The Opsimath (L’Étudiant tardif), écrivit des vers qui n’étaient pas, selon lui, de la poésie, mais plutôt « un condensé et une forme agréable de présentation de quelques pensées aléatoires » issues de sa « longue vie trépidante » [Henry J. Pfaff, Didactic Verses, 1983, avant-propos]. Et il ajoutait : « Je ne souhaite pas divertir, mais mettre le feu aux esprits tourmentés ! »
Quelques-uns de ces vers provocateurs résument sa propre conception wobbly du « Blanc » :
Call me red or call me brown.Call me black or call me pink.Call me yellow if you like;But please, don’t call me white [7].