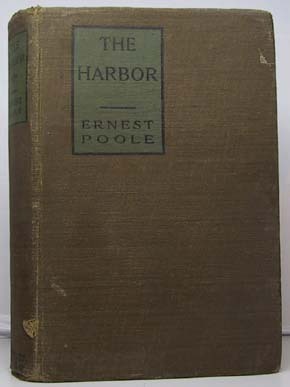Troisième volume — CHAPITRE XIII
Ces hommes-là, qu’espéraient-ils mettre à la place de la vie puissante qu’ils avaient réduite au silence ?
Dans un premier temps, seulement le chaos.
Me promenant le long du front de mer, je ressentais un sentiment confus de déception. Au delà de toutes mes questions une vague lueur d’espoir surgit de mon inconscient et me dit que j’assisterais à un miracle ici même. J’avais beau chercher une armée, je ne voyais qu’une foule d’hommes révoltés. Ils avaient formés des piquets de grève devant les quais, certains se précipitaient furieusement vers ceux soupçonnés d’être des « jaunes », d’autres se rassemblaient hâtivement autour de ceux qui prenaient la parole ou lisaient un journal. A nouveau ils s’amoncelaient dans les rues des bas quartiers d’immigrants grouillant de monde, s’entassant dans les cafés, exprimant les rumeurs les plus inconsidérées, discutant, criant, martelant les tables à grands coups de poing. Quant à moi, je ne trouvais là rien d’enthousiasmant — rien qu’une force épouvantable déchaînée et incontrôlable. Quel fou avais-je été d’avoir conçu ces espoirs. Le port ne laissait pas de place aux miracles.
Les meneurs de la grève semblaient incapables de maintenir l’ordre. Les quartiers généraux étaient dans un désordre indescriptible. La grande salle de réunion et les pièces attenantes étaient occupées par des masses d’hommes. Il n’y avait plus aucune pièce où l’on pouvait s’isoler et Marsh pouvait voir tous ceux qui arrivaient. Il serrait des mains constamment ou donnait, d’une voix traînante, des ordres de routine. Je voyais le visage de Joe Kramer penché au-dessus de son bureau où il signait et distribuait des cartes de membre du syndicat à une foule instable s’amassant autour de lui. Le visage de Joe était figé et hagard. Il avait passé toute la nuit assis derrière ce bureau.
« C’est sans espoir, pensais-je, ils ne peuvent rien faire. »
Le lendemain matin, quand je revins, je fus frappé de stupeur. Mystérieusement un certain ordre s’était installé. La foule de grévistes avait afflué dans la salle, occupé tous les sièges et puis s’était entassée le long des murs. Maintenant ils étaient tous silencieux et attentifs. Sur l’estrade étaient assis Marsh et les autres délégués. Devant eux, les trois premières rangées avaient accueilli le Comité Central, un parlement rudimentaire établi pendant la nuit. J’entendis que chaque membre avait été élu la nuit précédente par son comité de quartier. Ces corps de districts avaient d’une manière ou d’une autre été formés lors des deux derniers jours et des délégués avaient été élus au sein de ceux-ci. Les délégués s’étaient rassemblés pour s’occuper de la coordination et la foule, quant à elle, s’était rassemblée pour s’assurer qu’ils accomplissaient leur tâche comme il se devait. Voyant ce profond sentiment d’impatience se dessiner sur tous ces visages figés, un vague espoir se mit à nouveau à battre dans ma poitrine.
A ce moment, Joe m’aperçut. Il délaissa son siège immédiatement et se dirigea vers moi dans le fond de la salle. « Allez, Bill, dit-il, ta place est avec nous là-haut. » Et nous nous faufilâmes vers l’estrade où Marsh tendit le bras et saisit ma main . « Salut Bill, content que tu sois des nôtres » dit-il. Le ton de sa voix et ses yeux extrêmement amicaux qui avaient croisé les miens quelques instants, me firent frissonner légèrement. Puis ce fut fini. Le travail continua.
Au début, cela paraissait peu méthodique. Les rapports venant des districts étaient lus avec de fréquentes interruptions, des corrections insignifiantes et des discussions inutiles qui déviaient du sujet et me rendaient impatient. Cependant de nouvelles perspectives s’ouvraient à nous. Des télégrammes étaient lus à la douzaine, venant des syndicats du pays entier et des groupes socialistes de l’Est et de l’Ouest. Il y avait des télégrammes venant d’Angleterre, d’Allemagne, de France, de Russie, Pologne, Norvège, Italie, Espagne et même du Japon. Des « Salutations à nos camarades » affluaient en abondance du monde entier. Quelle armée ouvrière démesurée ! Soudainement la masse dense à l’arrière de la salle s’écarta afin de laisser passer un nouveau groupe d’hommes. De nouveaux grévistes grossirent les rangées, et à leur arrivée le travail fut interrompu, laissant place aux acclamations vigoureuses, aux grondements de pieds sur le sol et aux sifflements outranciers. Un véritable charivari !
Peu à peu je commençais à comprendre ce qui se passait dans cette salle. Ce premier « sentiment de grève » — vague, changeant et confus — se condensait comme dans une tempête, grandissant, s’épaississant, tourbillonnant et emportant toutes les forces émanant de la foule. Ce fut le premier réveil de cette pensée et de cette passion de la masse qui, lorsqu’elle atteignit son plein développement un peu plus tard, me fit prendre conscience des ressources profondément enfouies et des forces visionnaires longtemps refoulées que possèdent les hommes simples lorsqu’ils se rassemblent et s’unissent en une seule masse. C’est ici que, en peu de temps, naquit l’esprit de la foule.
Dès ce moment la foule posa des questions, pensa et planifia. Les idées furent exprimées pêle-mêle. J’eus l’impression que tout plan d’action, tout ce qui était senti, pensé et dit, même si cela provenait d’une seule voix, était transformé par la volonté de la masse, exprimé dans les bribes de discours, dans les applaudissements ou dans les éclats de rire, ou encore dans les silences froids réfutant toute idée non désirée. La masse exprimait sa volonté de plusieurs voix, de la bouche d’hommes qui, se dressant et parlant fort quelques instants puis se rasseyant, étaient vite oubliés. Certains se redressèrent après à plusieurs reprises, gagnant de l’assurance en pensée et en expression, d’autres retombèrent dans l’anonymat et se mêlèrent simplement à la foule. Mais ce fut grâce à la foule qu’ils avaient eu la force de s’élever et de s’exprimer.
Le premier jour de ce parlement ouvrier, un polonais avec un air impassible se leva. Il n’était pas membre du comité mais simplement membre de la foule.
« Vous envoyez un porte-parole à mon quai, dit-il, estacade cinquante-deux, rive Est. J’crois qu’y pourra faire que les gars se mettent en grève. » Il se rassit en respirant fortement. « T’as pas besoin de porte-parole, vas-y toi-même, cria un irlandais de l’autre côté de la salle.
— J’sais pas parler, dit le polonais avec emphase.
— T’es pas en train de parler là maintenant ? » Il y eut un éclat de rire et le visage du colosse rougit.
« Tu n’as pas besoin de parler, continua la voix, retourne simplement à ton quai et crie “grève” ! Tu as certainement assez de coffre, toi, le polonais. »
Le grand polonais se fraya un chemin vers la sortie. A l’arrière je le vis allumer sa pipe, tirer quelques bouffées et se renfrogner l’air perplexe. Puis il disparut. Le lendemain, au milieu d’une discussion, il se leva dans un autre coin de la salle. « Je voudrais dire que mon quai est en grève » cria-t-il. Personne ne semblait l’avoir entendu — cela n’ayant rien à voir avec le sujet de la discussion — mais il se rassit l’air fier de lui.
Un norvégien se leva et parla honnêtement dans un anglais que personne ne comprit. « Tais-toi, le suédois, apprends d’abord à parler anglais », cria quelqu’un. « Il n’y a aucune raison qu’il se taise » — la voix de Marsh l’interrompit et la masse confirma sa brusque réprimande par une rumeur d’approbation. Il se leva, vint vers l’avant et attendit qu’il y eût un silence absolu. « Tout le monde a le droit à la parole, dit-il, nous sommes plus de neuf nationalités différentes, mais ici chacun d’entre nous laisse la sienne au vestiaire. Tout le monde a droit à un traitement égal. C’est d’un interprète dont nous avons besoin. Y a-t-il quelqu’un qui puisse aider ce suédois ? »
Il y eut une rapide agitation dans la foule, ensuite un homme fut poussé vers l’avant. Il se dirigea vers son interlocuteur qui soudainement se mit à parler vivement.
« La première chose qu’il voudrait dire, dit l’interprète à la fin du torrent de mots, c’est qu’il préférerait être mort plutôt que suédois. Il dit qu’il est norvégien. Sa deuxième remarque est que toutes les querelles de nationalités doivent cesser si nous voulons faire aboutir la grève. Il dit qu’il a déjà vu des échauffourées entre irlandais et italiens. »
Un docker noir, énorme, se leva. On eût dit qu’il avait l’habitude de prêcher le dimanche.
« Oui, mes frères, cria-t-il, cessons nos bagarres. Arrêtons, abstenons-nous ! Nous sommes des hommes venant de tous les pays, Noirs et Blancs. Le dernier qui a pris la parole venait de Norvège — il est venu de là-haut, loin dans le nord, jusqu’ici. Mon père, lui, vient d’Afrique.
— Il a dû arriver lundi dernier alors, cria une petite voix sèche du fond de la salle. Il y eut un éclat de rire.
— Mes frères, cria l’homme noir, je suis venu ici pour les gens de couleur. Sur mon quai j’ai réussi à convaincre plus de soixante Noirs à se joindre à la grève. N’y a-t-il pas de place pour nous dans cette grève ? Si mon père était un esclave, ma couleur parle-t-elle encore contre moi ?
— Ce n’est pas ta couleur, c’est que t’es un briseur de grèves, interrompit une voix aiguë. La dernière grève fut un échec à cause de sales nègres comme toi. Ils vous ont amenés du sud dans des bateaux. Et toi, t’as refusé de faire la grève, pas vrai ? Espèce de jaune ! Espèce de nègre ! »
Un petit italien se leva d’un bond pour réagir. Il ne ressemblait pas à un docker. Il était habillé tout en couleurs avec un costume bleu soigné et une cravate rouge vif :
« Compagnons travailleurs, je suis italien ! Vous m’appelez rital, métèque, macaroni, vous appelez un autre nègre ou négro, encore un autre vous l’appelez youpin ! Arrêtons de nous insulter, appelons-nous “compagnons travailleurs” ! Nous sommes en grève, ne nous battons pas, soyons en paix, passons plutôt un bon moment ensemble ! Je connais un homme qui a un grand bateau et il m’a dit que nous pouvions l’avoir en échange de rien — pour emmener nos femmes et nos enfants en excursion tous les jours. Nous nous amuserons bien sur ce bateau. Je suis musicien, j’ai joué du violon sur un bateau jusqu’à ce que je me joigne à la grève. Maintenant c’est moi qui vous apporterai de la musique. Nous allons diriger ce bateau nous-mêmes. Nous avons nos propres dockers pour le faire démarrer, nous avons nos propres machinistes et nos propres mécaniciens, nous avons nos propres conducteurs — nous avons tous ce qu’il faut ! Ce sera facile de diriger ce bateau puisque le port sera désert. Le port entier sera à nous Peut-être qu’un jour, peut-être même bientôt, tous les bateaux du monde entier seront à nous ! Nous serons libres ! Nous enverrons tous les bateaux de guerre au fond de la mer et nous mettrons fin à toutes les guerres ! Commençons dès maintenant, arrêtons nos bagarres, sortons le bateau, tous nos camarades à bord ! Pas de négros, pas de nègres, pas de youpins, pas de ritals ! Compagnons travailleurs, je vais vous dire le nom de notre bateau : L’Internationale ! »
Le discours du petit homme fut accueilli par les clameurs du public. La foule avait dès le début perçu le danger que représentait cette haine raciale et s’était empressée de la réprimer. Le lendemain L’Internationale fit son premier voyage ; par la suite son voyage journalier fit partie de la fête de la grève. Les ponts du petit bateau qui vacillait étaient bondés : des grévistes, leurs femmes et leurs enfants. Le bateau louvoyait le long du port. Le petit italien et ses amis avaient imprimé une petite brochure de couleur rouge Chansons révolutionnaires de la mer. Sur le bateau, le petit italien chantait les couplets et la foule le rejoignait dans le refrain. Il devint une sorte de nouveau « chanty man », chantant les injustices, la révolte violente, les espoirs ranimés à vif et les désirs de tous les ouvriers de la mer — pendant que le bateau qu’ils dirigeaient eux-mêmes fendait les flots. Un jour je l’observais du bout de la jetée. Il approcha, emporté par les chants de plus en plus forts. Il vint si près de moi que je pus percevoir les visages empourprés de ceux qui chantaient, certains les yeux rivés sur le visage du meneur, d’autres chantant au rythme des flots comme s’ils propageaient au loin les prophéties exultantes de leur chant. Le bateau passa, les chants s’estompèrent au loin, et moi, je restais là émerveillé.
« Tous les bateaux du monde entier seront à nous ! Nous serons libres ! Nous enverrons tous les bateaux de guerre au fond de la mer et nous mettrons fin à toutes les guerres ! Commençons dès maintenant. »
Était-ce réellement un début ? Était-ce là le premier chant qui serait entendu dans le monde entier ? Je rejetai l’idée et pensais que ce n’était qu’une folie. Mais cette chanson continua de résonner dans ma tête. Quelle profonde force inébranlable que cette nouvelle force de la foule qui soudainement prit possession de ce simple musicien italien, ce joueur de violon, et qui en peu de temps mit dans sa musique le feu de ses plus grands rêves ?
Je vis cette force s’emparer d’autres. Un jour une jeune femme se leva dans la salle. C’était une sténographe travaillant sur un des quais. Elle était habillée avec soin et était plutôt coquette, mais son visage était blanc et figé. Elle n’avait jamais parlé en public auparavant. Tout d’un coup elle prit la parole comme emportée par une pulsion incontrôlable.
« Camarades, compagnons travailleurs. » Sa voix tremblait fortement. Elle fit une pause, se reprit et continua. « Et les femmes et les enfants, demanda-t-elle. Je connais un enfant qui est né la nuit dernière. Et ce n’est qu’un cas parmi d’autres. Il y a des centaines d’enfants et de personnes âgées, des malades, des infirmes, des ivrognes ; tous des laissés-pour-compte. Ils doivent être soutenus. Qui va s’occuper d’eux, les nourrir, les soigner ? Si nous voulons changer le monde, nous devons commencer par nous occuper des nôtres. Qu’en pensez-vous ? »
Elle se rassit avec un soupir de soulagement. Son siège étant près de l’estrade, je pus voir ses grands yeux excités à l’idée de ce qu’elle venait d’entreprendre. La foule, comme si elle avait attendu la venue de cette jeune femme pour exprimer sa pensée, réagit : des voix aiguës s’exclamèrent dans toute la salle. Certains connaissaient des médecins, d’autres des entrepôts vides et gratuits pouvant faire usage de centres de distribution de denrées alimentaires. Un assistant cuisinier qui travaillait sur un paquebot transatlantique dit où son chef se procurait des marchandises en gros. Oubliant sa nervosité, la jeune femme qui avait soulevé la discussion se releva à plusieurs reprises et fit tellement de suggestions que, quand vint le soir et que le premier centre de distribution de denrées alimentaires fut ouvert, elle fut l’une de ceux à qui on en confia la charge.
Je vis sa personnalité croître étonnamment car j’eus l’occasion de bien la connaître. Elle s’appelait Nora Ganey. Ce soir là, à la maison, quand Eléonore me dit « Souviens-toi, chéri, je voudrais faire quelque chose et faire ma propre idée sur la grève », je pensai directement au travail de secours et d’intendance. Eléonore serait parfaite pour ce genre de travail ; elle avait déjà de l’expérience dans des tâches similaires. Elle fut directement enchantée et le lendemain matin elle m’accompagna. Bien que de vies fort différentes, Nora Ganey et elle se révélèrent dès les premiers instants être des âmes sœurs. Eléonore dédia la moitié de son temps au travail et les deux femmes devinrent bonnes amies.
Avant la grève, Nora passait ses journées dans un bureau à taper à la machine. Plusieurs soirs par semaine elle se rendait à des bals dans des salles publiques : c’était sa vie. Pendant la grève elle se trouvait au centre d’aide alimentaire toute la journée et chaque soir elle visitait les foyers jusque tard dans la nuit ; elle apportait de l’aide et si le besoin se présentait distribuait des tickets alimentaires. Elle était attentive aux vécus les plus sordides des femmes des victimes du port et les racontait lors de ses discours. Peu de temps après elle fut envoyée dans toute la ville pour participer à des réunions et demander de l’aide. Un soir je me rendis avec Eléonore au Madison Square Garden pour écouter la jeune sténographe devant une foule de vingt mille personnes. La meneuse de grève qui prit la parole ce soir là ne fut plus la jeune femme que j’avais rencontrée deux semaines auparavant. Sa vie avait pris un tournant radical comme si elle était entrée dans un monde nouveau.
Pendant ces jours mouvementés, je me fis vite des amis grévistes par l’intermédiaire de Marsh et de Joe. J’eus de longues conversations intimes avec certains, je fus convié plusieurs fois à des repas de famille et passais beaucoup de soirées chez des gens qui habitaient dans des taudis. Bien que je me sentis petit à petit attiré par ces hommes qui m’appelaient « Bill », quand je me trouvais seul avec chacun d’entre eux, je ne ressentis pas ou à peine cette passion née de la foule. Tout d’un coup j’eus l’impression que ce nouveau monde avait disparu. Sa force et son ample vision me parurent de simples illusions. Que pouvions nous faire, êtres insignifiants, pour changer ce monde dirigé par et pour des hommes comme Dillon et autres « grands » que j’avais connus ? Souvent, face à des problèmes épineux sans solutions, je pensais avec une haine vorace à ces hommes là-haut, à leur esprit vaniteux et à leurs riches connaissances en affaires. Je me sentais mêlé à une populace désespérée, une sombre et profonde jungle d’esprits ignorants. Et cherchant en vain un point d’appui, je ne trouvais que le chaos.
Nous rejoignîmes la masse, et là, en un clin d’œil, nous fûmes emportés. Une fois de plus nous fîmes corps avec elle. A nouveau me vint la vision, le rêve d’un monde las, libéré, un monde où pauvreté, souffrance et amertume pourraient un jour être anéantis par cette géante en pleine affirmation de soi. Peu à peu je commençai à comprendre ce qu’elle voulait, ce qu’elle haïssait, comment elle planifiait et comment elle agissait. Ceci fut un miracle pour moi, le grand miracle de la grève. Pendant des années je m’étais entraîné à me concentrer sur un homme à la fois, à rejeter tout le reste pendant des semaines et des semaines, à sentir cet homme si fortement que son esprit entrait en contact avec le mien. Maintenant, avec la même intensité, je m’efforçai jour et nuit de sentir non pas un mais des milliers d’hommes, une masse confuse et désorientée. Petit à petit dans mon combat, je les sentis se fondre en un grand être, me regardant avec deux grands yeux, me parlant d’une voix grave et me remplissant d’une passion ardente pour la liberté de l’homme.
Était-ce encore un nouveau dieu, à rajouter à tous les autres ?